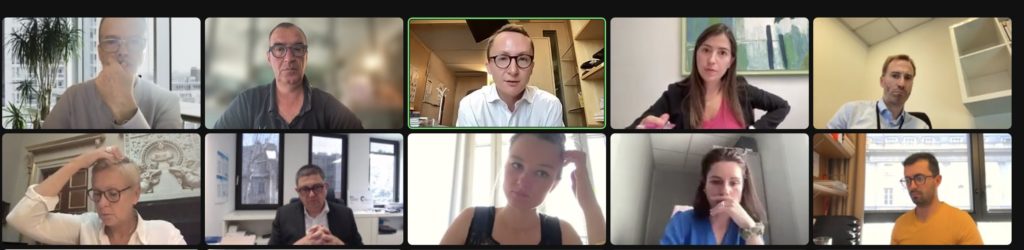Juste reconnaissance que celle du mérite qui te revient, car du mérite pour sensibiliser aux risques cyber il en faut toujours et encore. Congrats !

Juste reconnaissance que celle du mérite qui te revient, car du mérite pour sensibiliser aux risques cyber il en faut toujours et encore. Congrats !

Très bons échanges avec Fabrice Jaubert en charge de Google Safe Browsing dans le cadre du projet de loi de sécurisation des espaces numériques.
Selon les mêmes principes que GSB, notre filtre anti-arnaque protègera les utilisateurs de la cybermalveillance du quotidien.


Nous devons nous saisir de ce texte pour la promotion d’un cadre expérimental en faveur des JONUM*, et réaffirmer que la France sera le leader sur ce marché. J’y suis attentif.
*Les JONUM, jeux à objets numériques monétisables, sont un nouveau type de jeux en ligne, à la croisée entre les jeux d’argent et de hasard et les jeux vidéo, présentent de nombreux risques : addiction, blanchiment d’argent…
https://www.vie-publique.fr/loi/289345-securiser-et-reguler-lespace-nunerique-projet-de-loi-sren
Audition du dispositif national d’assistance aux victimes de cybermalveillance et de sensibilisation aux risques numériques aujourd’hui sur le filtre anti arnaques.
Je le redis, Je souhaite que la liste des adresses de compromission soit publique. Pour plusieurs acteurs, le filtrage suffit. Inutile de passer au blocage. Mais obligation d’implémenter la liste.